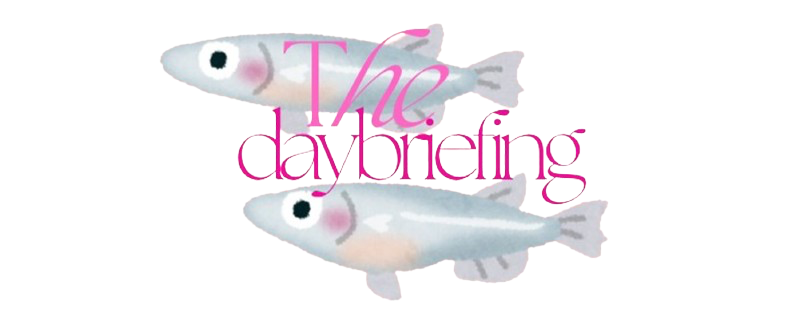Nadja Makhlouf ou la photographe qui murmurait à l’oreille des femmes
Janvier 2022, je rencontre Nadja Makhlouf lors d’un club de lecture. Vient alors l’idée de l’article que vous allez lire aujourd’hui. Il ne s’agit pas d’une interview mais bien d’un portrait de la photographe. Zoom sur celle qui se cache derrière l’objectif.
Je choisis de publier cet article aujourd’hui, mercredi 15 juin, pour une raison bien particulière. J’aime les symboles et il s’avère qu’un certain 15 juin 1956 est né le journal algérien El Moudjahid. Organe officiel de communication du Front de libération nationale (FLN), publié du 15 juin 1956 donc, au 5 juillet 1962, on le retrouve en deux éditions, française et arabe. J’ai choisi cette date car j’ai d’abord découvert le travail de Nadja à travers ses portraits de Moudjahidate, ces femmes combattantes pour l’indépendance de l’Algérie. À mon tour alors de lui tirer le portrait en espérant que les détails que j’ai sélectionnés lui donneront sa ressemblance.
Raconter le quotidien des femmes
J’ai rencontré Nadja Makhlouf, par « hasard » en janvier dernier lors d’un des clubs de lecture organisé par Sawt Enssa autour des féminismes islamiques. Je mets le mot hasard entre guillemets car je n’y crois pas. Pour moi, chaque rencontre survient à un moment donné et pour une raison bien précise. Passons. Je l’ai donc rencontrée au détour d’un café avec un groupe d’autres femmes. On s’est chacune présentées puis c’était autour de Nadja. Elle est photographe, elle nous parle de son travail, de ces combattantes algériennes qu’elle a photographiées et de son projet actuel sur les femmes féministes dans l’islam. Les heures passent et le club de lecture touche à sa fin, on s’échange nos comptes Instagram et on se quitte un peu sur notre faim.
C’est une fois dans le métro que je découvre son art… Des photos de famille, de vacances, de manif, de la couleur, du noir et blanc. On se revoit quelque temps après à une nouvelle session du club de lecture toujours organisé par Sawt Enssa. On discute de nouveau et puis, vient l’idée d’un article. Pas une interview, car ça il y en a déjà sur Nadja, mais plutôt un portrait. Je ne sais peut-être pas dessiner mais j’aime écrire. On se retrouve alors des mois après, pendant le Ramadan, et on part sur deux bonnes heures de conversation. Nadja est passionnante. Après un Master autour de l’image documentaire à Aix-Marseille, elle retourne vivre à Paris. Elle participe à un projet qui l’amène à aller au Sénégal et au Cap-vert. « À partir de là, j’ai eu plusieurs expériences en France comme à l’étranger. C’est en 2011 que j’ai commencé à faire un projet autour d’une trilogie de portraits de femmes en Algérie, à travers trois régions que sont la Kabylie, Alger et le désert car je crois que selon l’espace et selon l’environnement, la place de la femme dans la société est différente, son rapport à l’autre aussi », m’explique-t-elle. Et d’insister : « C’était important pour moi de ne pas les stigmatiser et de ne pas les arrêter à travers une seule ville. Ces trois régions étaient pour moi symboliques et représentaient quand même bien l’ensemble de la diversité culturelle en Algérie. À chaque fois, je voulais raconter le quotidien des femmes et je voulais aussi raconter ce qu’elles vivaient dans une société souvent considérée comme étant patriarcale alors que c’est beaucoup plus complexe que ça».
Mettre en lumière des personnes qu’on invisibilisait
Je lui demande alors pourquoi avoir choisi la photo comme mode d’expression et pourquoi pas l’écrit, par exemple. Nadja se raconte alors. « J’aime beaucoup écrire. D’ailleurs, depuis petite j’ai des journaux intimes. Je dois en avoir une bonne vingtaine dans le garage de mes parents », débute-t-elle. Qu’on ne se trompe pas, Nadja continue à écrire « mais surtout à des moments fort de [sa] vie ». Elle m’explique : « Je crois que si j’ai été vers l’image c’est parce qu’on n’avait pas beaucoup d’images d’archives. J’aurais aimé voir des photos de mes parents, de mes grand-parents, de mes arrière-grand-parents. Je n’en n’ai pas du tout… sauf une seule, de ma grand-mère maternelle, que je n’ai jamais rencontrée ». Tout part alors d’un manque et d’« une espèce de vide » qu’elle a voulu « combler » par l’image, comme elle me le confie.
« Au début, c’était à travers les documentaires que je voulais raconter des histoires, j’aimais la temporalité d’un film, les silences qui en disent long, les timbres de voix, les ambiances… J’aimais aussi le fait qu’on puisse mettre en lumière des personnes qu’on invisibilisait, c’était et ça reste très important pour moi », souligne Nadja Makhlouf. Le déclic ? La photographe est catégorique : « C’est lorsque j’ai commencé mon travail sur les femmes combattantes que j’ai eu envie de faire de la photo. Pour une fois, je racontais l’histoire de toutes les femmes combattantes et pas seulement deux ou trois, ce qui aurait été le cas si j’avais fait un film documentaire. Il y a toujours le choix et le nombre de personnages dans un film. Pour ce nouveau projet, ça n’allait pas être le cas. C’était ce que je voulais. Dresser un éventail de portraits de toutes ces Moudjahidate ». Sur son rapport avec l’Algérie, Nadja me dévoile qu’elle y allait « tout le temps » quand elle était plus jeune, « quasiment toutes les vacances (…) soit en bateau, soit en avion ». Elle poursuit : « Mon grand-père venait tous les six mois. Je n’étais pas du tout coupée de l’Algérie. Ça a été hyper important qu’il y ait une transmission, surtout venant de ma mère. L’apprentissage de la langue, des rites, des coutumes, de la culture… ». Nadja est d’origine kabyle. Elle parle et comprend « très bien » le berbère même si elle confesse qu’ « il y a des mots qui manquent ». Je croise nos parcours et nos questionnements.
Ma double identité, c’est ma force mais… c’est aussi une faiblesse
NADJA MAKHLOUF
Quand j’allais en Algérie, on me disait souvent « Est-ce que c’est mieux ici ou là-bas ? ». Je demande alors à Nadja d’où on est, selon elle, quand on naît en France, qu’on y grandit et qu’on est aussi Algérien. Sa réponse ne tarde pas et elle est nuancée. « Je crois que l’identité se construit différemment selon le lieu de naissance et ce que l’on fait de notre héritage familial. Pour ma part, je fais partie de la deuxième génération d’enfants d’immigrés, pour être honnête, je te dirais que pendant longtemps, je ne me suis pas sentie chez moi ici en France alors que là bas, je retrouvais mes fondations », m’explique-t-elle d’abord. Pour elle, « ça a pris beaucoup de temps avant qu’[elle ne se] réconcilie avec la France car « Il en faut du chemin pour trouver la paix ». Et de poursuivre : « Ma double identité, c’est ma force mais c’est aussi une faiblesse, et parfois une déchirure… »
Nadja a fait du chemin depuis ses débuts et continue d’en faire. Elle a exposé son travail à New York, Londres, Genève, Paris mais aussi à Alger pour ne citer que ces villes. À travers son travail, elle a voulu récolter la parole manquante de ces femmes algériennes combattantes qu’on a laissées tomber aux oubliettes de l’histoire. Était-ce une responsabilité, un devoir pour Nadja ? « Pour ce projet, c’est d’abord la colère qui m’a animée et ensuite la frustration. J’avais l’impression que je ne connaissais rien et que ça faisait de moi une femme ignorante », se souvient-elle. Vient ensuite un constat de taille puisqu’elle découvre que ce ne sont pas une ou deux femmes qui ont combattu. C’est là qu’elle comprend que le projet va être titanesque. Elle se rappelle : « À l’époque, je ne me rendais pas compte du résultat mais plutôt du travail colossal que ça allait demander car j’étais en solo de A à Z. Je me suis dit ‘Par où commencer ? Comment commencer ?’. Ça a été par étape. Je suis allée en Algérie, j’ai demandé à des amis, j’ai rencontré des femmes puis celles-ci en ont parlé à d’autres ». C’est quand elle réussit à toucher plusieurs femmes de confiance que ça fait ricochet et que d’autres acceptent de témoigner, de s’ouvrir.
Les combattantes anonymes… grandes oubliées !
C’est aussi un sentiment de devoir qui a animé son travail colossal. « Devoir de mémoire, de responsabilité, devoir nécessaire de mettre en lumière ces femmes combattantes et surtout les anonymes » car « dans l’imaginaire collectif, les héros existent et dans chaque guerre, on a besoin de se raccrocher à des héros. Il y en a dans l’histoire française, américaine… Il y en a dans toutes les sociétés. Mais Nadja tient à nuancer cette vérité générale : « À titre personnel, ce qui me faisait halluciner c’était que les anonymes on n’en parlait pas ! C’est pour cela que j’ai fait ce travail-là ! ». Alors elle se lance dans ce travail qu’elle qualifie de « fourmi » tant il y a à faire. Ces femmes ? Elles lui ont ouvert leurs portes, elles l’ont accueillie chez elles. « On parlait longuement, longtemps de nos vies de femmes, de nos choix. Elles étaient d’abord surprises, puis contentes et touchées. Je partageais avec elles mes intentions et aussi ma trajectoire de femme. Nos échanges se sont créés dans l’intimité et c’est comme ça que la relation s’est construite. Je n’ai pas fait ce projet seule, je l’ai fait avec elles », tient-elle à souligner.
J’ai tout quitté, en France, pour aller faire ce travail
Nadja Makhlouf
Admirative de ce qu’elle a réalisé, je me demande si Nadja est bien consciente de la portée, de l’impact de ses travaux et de la beauté du sentiment qu’elle a procuré à ces femmes en les rendant visibles. Elle me raconte : « Elles étaient en souffrance de ne pas être reconnues, d’être invisibilisées pendant cinquante ans… C’était douloureux pour elles. Quand d’autres étaient connues, mises sur le devant de la scène, elles, elles étaient silenciées. J’ai tout quitté, en France, pour aller faire ce travail. Chaque matin, je me réveillais avec elles, je m’endormais avec elles, je lisais tout ce que je pouvais trouver sur elles et il n’y avait qu’elles, qui existaient. C’était devenu une obsession ». Nadja Makhlouf explique qu’elle ressentait « une urgence ». Pour elle, c’était maintenant ou jamais. « Dans mon esprit, elles allaient finir par mourir, peut-être perdre la mémoire, être dans l’incapacité physique et/ ou émotionnelle de transmettre leurs histoires. Je ne me rendais pas compte de la portée de ce travail. Je ne le réalise que maintenant, pour le 60è anniversaire de l’indépendance de l’Algérie », confie celle qui continue de murmurer à l’oreille des femmes.
Nadja se veut optimiste : « Ce travail de mémoire servira à d’autres générations et pour tous les combats qu’il reste à mener en tant que femmes ». De ce travail titanesque, elle garde des souvenirs fous comme lors du vernissage de son exposition au Musée d’art Moderne d’Alger (MAMA). « C’était l’un des moments les plus beaux de ma vie. Elles étaient presque toutes là et elles se sont toutes vues en grand parce que c’était des tirages uniques de 60×80 (…) À ce jour, c’est pour moi la plus belle de mes expositions. Elle a accueilli l’intégralité des portraits. Ces femmes pour la première fois de leur vie, se sont vues en grand. Elles ont vu des gens qui les regardaient, qui ont reconnu leur investissement, leur engagement. Elles étaient très touchées, émues. Je ne m’en rendais pas compte sur le moment », concède la photographe qui a souhaité vendre les tirages de ses clichés au MAMA afin d’éviter « qu’ils soient rachetés par un autre musée ». Pourquoi ? D’abord dans un souci d’éthique et d’engagement, puis, pour éviter « une spoliation des archives et de facto de l’histoire ». Avec son geste et son merveilleux travail de mémoire, Nadja Makhlouf souhaitait rendre à César(ée)* ce qui lui appartient et c’est bel et bien chose faite !
* Césarée de Maurétanie (actuelle Cherchell) est une ancienne ville sur la côte méditerranéenne de l’Algérie. Elle a été la capitale du roi berbère Juba II.
Crédit Une : Daniel ©
L’info en + : Nadja Makhlouf (pour suivre son travail, c’est par ici) sera présente le dimanche 10 juillet prochain au FGO Barbara de 16h à 19h à l’occasion de la projection du documentaire « Indépendance algérienne : Les femmes oubliées de l’histoire ? » organisée par l’association Sawt Enssa (pour les suivre sur Instagram, cliquez ici).