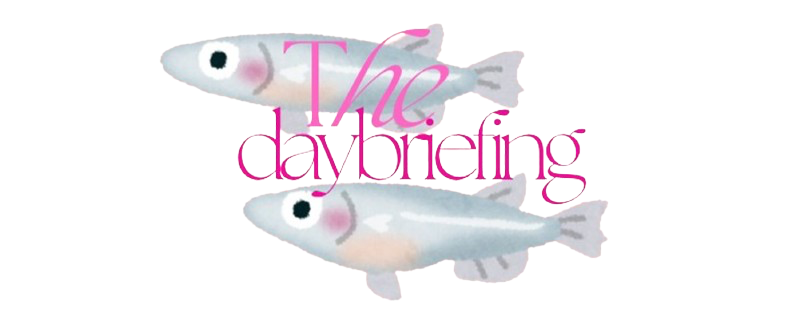L’écrivaine Sarah Ghoula sort de son silence pour nous parler de son premier roman
Après avoir lu Nos silences sont immenses, le premier roman de Sarah Ghoula, j’ai eu envie de lui poser tellement de questions. J’ai plié des pages, pris des notes, souligné au crayon certains passages de son excellent ouvrage… Et figurez-vous qu’elle m’a fait l’immense honneur d’accepter de répondre à mes nombreuses demandes. Je vous laisse découvrir les réponses sans plus attendre !
Avant de vous laisser avec notre riche échange, je dois vous dire quelques mots sur Nos silences sont immenses, sorti en mai 2022, afin que vous compreniez la portée et l’importance de ce récit. C’est l’histoire de Zohra, dernière fille de Salma qui se considère comme maudite car elle ne peut enfanter de garçon. Quand Zohra naît, c’est donc… le drame et sa mère pense que l’avenir de la fillette sera loin d’être radieux. À travers le parcours de cette dernière, on entrevoit une Algérie colonisée avec une Zohra qui va nous permettre de transiter entre deux mondes. L’héritage spirituel et traditionnel est au centre et on s’oublie à travers le regard si particulier de Zohra, atteinte d’hétérochromie (une anomalie de la pigmentation qui se traduit par des yeux de couleur différente), qui aura pour mission d’ « ôter la douleur avant qu‘elle ne se transforme en souffrance ».
Ce livre m’a véritablement marquée car en 168 pages, Sarah Ghoula parvient à nous emmener dans le village d’Aïn Zarga, en Algérie, suivre le parcours de ce petit bout de femme qu’est Zohra et qui deviendra donc bientôt une grande guérisseuse. Etant moi-même algérienne, je peux témoigner que dans notre culture, et surtout chez les générations passées, on n’était pas habitué à parler de nos émotions, de notre vécu… Il y a eu beaucoup de non-dits et je trouve que c’était très beau de la part de l’écrivaine de mettre en avant ces silences immenses, par pudeur, à travers une telle histoire. Je tenais aussi à souligner l’idée géniale d’avoir écrit un récit qui se passe dans une petite ville d’Algérie plutôt que dans les grandes villes « habituelles ». Ça fait un bien fou de lire une « autre » Algérie et de montrer que si nos silences sont immenses, notre diversité aussi ! Trêve de bavardages, je vous laisse ENFIN avec l’entretien que Sarah m’a gentiment accordé et vous invite VIVEMENT à lire ce premier roman brillant. Sûrement l’une de mes plus belles lectures de ces dernières années alors imaginez ma joie d’avoir pu en discuter directement avec son auteure…
Qui êtes-vous Sarah ?
Je viens de région parisienne où j’ai grandi. Mes parents sont d’origine algérienne, et j’ai eu un parcours très classique. Mon père était professeur de maths et ma mère gardait des enfants. Dès l’enfance, il y a eu une place très importante pour le livre parce que mes deux parents étaient de grands lecteurs. Ma mère en arabe et mon père dans les deux langues. Il y avait donc une grosse consommation de livres et je suis tombée dedans très jeune et c’est aussi à ce moment que j’ai commencé à écrire. Pour eux, c’était tout à fait normal que j’écrive…
Vous vous êtes donc tournée vers des études littéraires ?
J’ai d’abord obtenu un bac scientifique et après ça, j’avais le choix de faire ce que je voulais. J’aimais beaucoup lire et je voulais écrire mais aussi savoir comment se construisait l’écriture. J’ai donc fait une licence de Lettres modernes à La Sorbonne et j’ai ensuite intégré l’École Normale Supérieure en tant que mastérienne. J’ai suivi un Master en Lettres modernes et je me suis spécialisée dans la rhétorique, ou, selon moi, l’atelier où l’on forge les mots. C’était très important pour moi et j’ai ensuite passé mes concours pour l’enseignement. J’ai enseigné pendant cinq ans au collège et durant huit ans à l’université mais je ne le fais plus aujourd’hui.
Pourquoi avoir arrêté ?
J’ai certes complètement arrêté l’enseignement dans ces établissements mais je continue à donner des cours d’écriture romanesque à des personnes qui demandent à apprendre à écrire. Je suis plutôt tournée sur d’autres projets à côté…
Nos silences sont immenses est votre premier roman. Quel est votre rapport à l’écriture ?
J’ai commencé à écrire très jeune et d’abord pour moi. Puis, arrivée à la fac, j’ai commencé à écrire des nouvelles assez brèves. Certaines ont même remporté des concours et c’est un peu comme ça que j’ai commencé à me faire un petit réseau d’écriture. Suite à mon premier concours, que j’ai remporté, je suis restée en contact avec l’écrivaineDominique Barbéris qui était la présidente du jury. Elle animait un cours d’écriture romanesque à La Sorbonne et elle m’y a invitée. En termes de capacité d’accueil d’étudiants, c’était plutôt compliqué mais elle m’a quand même demandé de venir pendant deux ans. J’avais en tête l’image des ateliers un peu à l’américaine…
Comment se passait cet atelier ?
Cette prof était vraiment géniale parce qu’on était un petit groupe et qu’on avait un exercice qui durait 2/3 semaines sur un thème bien précis. Il n’y avait pas d’évaluation et je trouvais ça génial. Elle mettait directement des 17 à partir du moment où la personne avait rendu tous ses devoirs. Elle disait qu’elle ne notait pas la qualité du devoir mais plutôt la quantité de devoirs rendus. On lisait à voix haute nos passages et on se faisait des retours pour se dire ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Ça a été très formateur pour moi parce que j’ai senti la différence entre l’avant et l’après de cet atelier. J’ai commencé à vraiment appliquer ses conseils sur ma manière d’écrire. J’ai compris que ce n’était pas ma voix qui comptait dans mon écriture mais plutôt la manière dont j’allais faire acheminer des histoires.
Je suis restée sur ma faim à la fin de Nos silences sont immenses. J’imagine que c’était votre intention ?
Si vous saviez le nombre de messages d’incompréhension que j’ai reçus à ce sujet (rires). Plus sérieusement, ce qui a joué dans l’écriture de ce livre, c’est que j’écrivais beaucoup de nouvelles et les nouvelles, ce sont des chutes et j’ai eu du mal à finir de l’écrire. D’un autre côté, il y a aussi ce ‘moi, lectrice’ qui aime bien quand il termine de lire une histoire de ne pas avoir toutes les clés en main. J’aime pouvoir laisser de la place à mon imaginaire et me dire à la fin qu’ « un tel est devenu ceci, un autre cela », ce n’est pas trop ce que je préfère. J’aime me dire que je vous ai prêté les personnages pendant tout le livre et que maintenant vous pouvez en faire ce que vous voulez. Pour Nos silences sont immenses, ce n’est pas dit que j’exclus une suite mais pour l’instant, ce n’est pas d’actualité. J’avais plus de matière que ce que j’ai mis dans mon ouvrage mais je trouvais que c’était bien que ça finisse comme ça. Le côté un peu bref s’explique aussi par le fait que j’ai écrit en « style nouvelle ». J’ai essayé de penser chaque chapitre un peu comme une nouvelle avec une chute indépendante.
Comment vous est venue l’idée de ce livre ?
J’écrivais beaucoup de nouvelles et j’avais déjà été approchée par un éditeur qui m’avait dit ‘ok pour les nouvelles mais en France, on veut lire des romans’. Pendant des années, j’avoue que je disais ‘je suis sur mon premier roman’ et j’avais écrit deux lignes (rires). J’avais deux sujets de romans en parallèle et en réalité, l’histoire que j’allais écrire était celle de Lahcen, le petit garçon qui vient au début du livre chez Zohra. À la base, mon roman, c’est lui, puis j’ai fait une digression d’un paragraphe au début sur Madame Zohra et ça m’a plu alors j’ai continué. De là, je me suis dit ‘allez je vais en faire un chapitre’…
Comment s’est passée l’écriture de ce premier roman ?
J’écrivais des petits morceaux et puis le premier confinement est arrivé. Le gros du roman m’a pris trois semaines à écrire, c’était une écriture fleuve et je dirais même une propulsion. J’ai beaucoup peaufiné ensuite et c’est là que j’ai ressenti la différence avec la nouvelle que j’avais l’habitude d’écrire en un jet. Sur un roman, ce n’était pas possible et ça m’a appris à travailler différemment. J’insiste sur le fait que le travail de réécriture et ce qui s’en suit prend aussi énormément de temps. Pour en revenir à la genèse de ce livre, j’ai écrit beaucoup de nouvelles sur les enfants à qui il est arrivé des choses assez dramatiques et la question des enfants livrés à eux-mêmes m’importait de plus en plus. Pour le personnage de Zohra, je m’interrogeais sur ces femmes qui sont parfois seules et dont on ne connaît pas l’histoire. On projette plein d’avis et d’idées préconçues sur ces femmes. On a l’habitude d’entendre parler du travailleur immigré qui vient avec femme et enfants mais on ne met pas vraiment en lumière ces autres femmes qui n’ont pas d’enfant, pas de mari et qui vivent souvent seules…
Votre histoire personnelle est-elle pour quelque chose dans votre choix d’écrire sur une Algérienne ?
Alors c’est très drôle mais ce qui m’avait beaucoup freinée pour mon premier roman, c’est que je m’étais toujours dit que je n’écrirais pas sur l’Algérie. Je m’étais dit que je refuserais de faire un premier roman sur l’Algérie parce que déjà j’y suis seulement allée en vacances et je ne me sentais pas légitime… Il y a aussi cette question de double nationalité et je ne voulais pas être catégorisée comme la femme d’origine algérienne qui écrit sur l’Algérie et qui malgré elle, a un biais et qui viendrait juger.
Justement, quel est votre rapport avec l’Algérie ?
Je suis allée très régulièrement en Algérie, pour des mariages et pour des deuils où j’étais réunie avec ma famille. Je viens d’une partie de l’Algérie dans le sud-est, aux portes du désert, qui est beaucoup moins connue donc je voulais parler d’une femme qui a un certain savoir, et vers ma région, le savoir du soin est très important. C’est comme ça que ce personnage secondaire a pris le dessus. Mon livre n’est en rien de l’écriture autobiographique mais oui, il y a des parties de mon roman qui sont fortement inspirées des récits de mes tantes. Je sentais que la richesse de ces récits se perdaient… Il y a le problème de ces femmes qui ont vécu des histoires extraordinaires mais dont les récits, si ils sont racontés, ne doivent pas sortir du cercle privé car il y a la question de la pudeur. Quand on vit quelque chose de difficile, on l’encaisse… Il y a beaucoup de sous-entendus et c’est l’une des difficultés que j’ai rencontrées en écrivant ce roman. J’ai voulu retransmettre les manières imagées et métaphoriques avec lesquelles on m’a raconté certaines histoires. Je voulais faire comprendre que cette manière de parler à travers les images en disait long sur ces femmes. Des Zohra, il y en a plein partout… Des femmes seules que l’on ne calcule pas trop alors qu’elles ont parfois des histoires dingues ! L’idée était de se dire que ces femmes existent même si elles ne disent rien d’elles. Avec l’histoire de Zohra, j’ai voulu souligner qu’une vie, c’est très complexe. Il faut parfois affronter certains silences mais aussi les accepter.
Vous racontez l’Algérie colonisée à travers le parcours de Zohra. Comment vous a-t-on raconté à vous cette histoire ?
Avec mon père, on n’en parlait pas beaucoup. Il était très très jeune à l’époque donc il n’avait pas vraiment de souvenirs. Alors quand il me racontait cette période, c’était plutôt à travers ce que des proches lui avaient raconté. C’était très rapide, il n’entrait pas dans les détails. Du côté de ma mère, c’était très différent. Mon grand-père maternel avait participé activement à la guerre d’Algérie. Il venait d’un petit village et c’était un peu le héros de ce village. Quand j’étais petite, je ne comprenais pas et les gens disaient ‘ah c’est la petite-fille de…’. Je ne l’ai pas connu et même ma mère ne l’a pas énormément connu car elle l’a perdu quand elle n’avait que 11 ans. J’aurais aimé faire ce travail de recherche de faits historiques mais on était plutôt sur des histoires qui allaient jusqu’à la légende. Ce qui est bien, c’est que ma grand-mère avait conservé plusieurs documents de mon grand-père donc j’ai pu lire des choses sur cette participation. Je dirais donc qu’au sein de ma famille, j’étais entre les deux, c’est-à-dire que j’avais soit le silence, soit le côté un peu légendaire et ce n’était pas facile de faire la part des choses. Dans mon livre, j’ai préféré suggérer car je me disais ‘je ne pourrais jamais être juste, je ne suis pas historienne’. Je n’avais pas du tout pour vocation de faire un roman historique donc j’ai choisi que la colonisation soit en arrière-plan. Je ne voulais pas non plus que les gens pensent que dans le village du roman c’était un paradis sur terre, il fallait donc quand même laisser entrevoir cette violence.
Vous évoquez le rapport aux malédictions, aux superstitions et au rejet à cause de la différence. Avez-vous pioché dans des récits déjà entendus ? Vous êtes-vous documentée à ce sujet ?
Je pense qu’il y avait des savoirs qu’on interprétait correctement et qui ont commencé à prendre trop de place et qui sont tombés dans la superstition… Sur la question des yeux, c’est totalement sorti de mon imagination. Je voulais quelque chose d’un peu mystique et je trouvais que c’était une bonne idée pour souligner le fait que naître avec une ‘malformation’ entraîne tout un cheminement de pitié. Tant que c’est un être chétif, il y a de la pitié et avec le temps s’ajoute le rejet. Les traditions, mais aussi les expressions de malédiction sont très présentes dans mon livre mais je voulais décrire le moins d’éléments possible pour toucher un lectorat plus large. Je me disais qu’il fallait à la fois expliquer les choses à des personnes qui ne connaissent absolument pas l’Algérie mais sans non plus en faire un documentaire. D’ailleurs, il y a souvent la répétition qui vient pour sous-entendre l’importance et l’ampleur que ces choses-là ont dans ce récit.
Est-ce qu’on peut dire que vous avez fait à la fois de l’ethnologie et de la sociologie avec votre livre ?
Je ne le revendique pas vraiment mais oui, il y a quand même une part de ça. Par exemple, pour les descriptions des soins je me suis renseignée et j’ai beaucoup observé les relations entre les personnes d’un même village. Quand je vais en Algérie, je sens que mon mode de fonctionnement change par rapport à autrui. Là-bas, il y a des choses totalement différentes et des codes à avoir très importants. C’est très imprégné et pour l’avoir expérimenté et observé, j’ai fait en sorte d’être la plus fidèle et la plus précise possible sur le côté sociologique.
Qu’a pensé votre famille de votre roman ?
Mes parents ont lu mon livre et ma famille l’a lu avant et après la parution. Mon père a d’ailleurs été l’un de mes correcteurs. Je lui avais notamment demandé de le relire surtout pour être fidèle à tout ce qui touchait au village et éviter les incohérences. Les amis de mes parents étaient également très contents de voir que leur région en Algérie était représentée. Et je ne me rendais d’ailleurs pas compte de ce que ça pouvait représenter pour eux. Mon père me disait ‘ça veut dire que maintenant je peux trouver ton livre avec ton nom ?’. Ma famille m’a beaucoup soutenue et est très fière que mon premier roman ait porté sur l’Algérie.
Prévoyez-vous un prochain roman ?
J’écris toujours sur différents domaines en même temps et j’ai tout un univers dans ma tête. Peut-être qu’on retournera un peu en Algérie mais ce n’est pas ce qui prédomine sur ce que j’écris en ce moment. J’ai deux projets d’écriture en cours dont un roman qui est encore à ses balbutiements et peut-être un recueil de nouvelles. Je me dis que pour l’instant c’est comme ça mais peut-être que ça changera dans quelques mois. Et pour en revenir au personnage de Lahcen, peut-être qu’on le retrouvera parce que j’ai l’impression qu’il vit encore en moi dans un coin de ma tête. J’espère vraiment finir un projet d’écriture en cette année 2023 pour une sortie en fin d’année voire en début 2024 si je me tiens à mon rythme d’écriture.
Qu’avez-vous envie de raconter dans vos prochains écrits ?
La question principale qui m’intéressait initialement, au-delà de la transmission, était celle de la marge. C’est étrange mais j’ai envie de mettre en lumière tous ceux qu’on met de côté et qu’on n’a pas ou plus envie de regarder. La plupart de mes écrits a pour but de donner de la voix à ceux qu’on n’écoute pas. La parole manquante est un sujet qui m’a toujours animée. Pour Nos silences sont immenses ça a donc pris la forme de la transmission mais il y a tellement d’autres formes et de façons de parler de ça. J’aimerais aussi parler de la question de l’immigration dont le traitement que les médias en font aujourd’hui m’excède de plus en plus. Je suis choquée par la capacité humaine de certains à s’aveugler et à se taire face à toute cette violence. Cela dit, je ne veux pas écrire d’histoire clichée et j’aimerais traiter plus profondément ce sujet pour comprendre pourquoi on rejette…
Nos silences sont immenses, de Sarah Ghoula, éd. Faces cachées, 168 pages, 14 euros
Crédit Une : Linda Rachdi